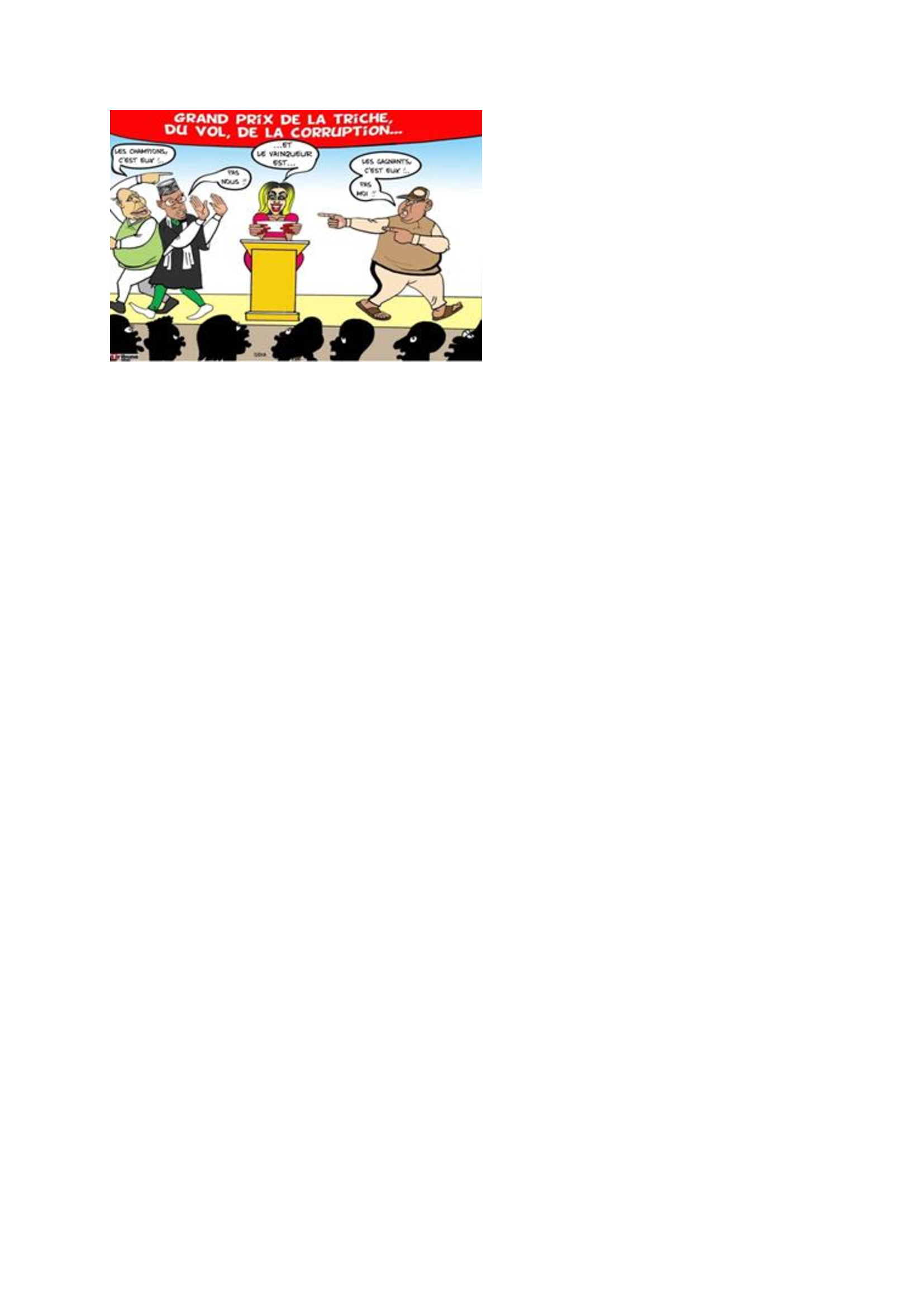Le CELFA (Centre d’Études Linguistiques et littéraires Francophones et Africaines) est l’un des centres les plus anciens de l’Université Bordeaux Montaigne. Il est l’émanation du CELMA (Centre d’Études Littéraires Maghrébines, Africaines et Antillaises) fondé en 1969 par les Professeurs Guy Turbet-Delof, Simon Jeune, Michel Hausser et Jack Corzani. Le CELMA s’est transformé en CELFA en 1993 et a été dirigé par les Professeurs Jack Corzani (1993-1998), Martine Job (1998-2002), Musanji Ngalasso-Mwatha (2002-2013), Jean-Michel Devésa (2013-2015). Il est aujourd’hui dirigé par le Professeur Alpha Barry.
Après avoir fait partie de l'équipe d'accueil EA 536 Littératures française, francophones et comparées, puis de l'EA 3655 Textes et Cultures, ensuite de l’EA 4198 LAPRIL (Littératures, Arts, Pluridisciplinarité, Représentations, Imaginaire, Langages), le CELFA a été intégré à l’EA 4593 CLARE (Cultures, Littératures, Arts, Représentations, Esthétiques), puis à l'UR 24142 Plurielles (Unité de recherche en langues, littératures et civilisations) de l'Université Bordeaux Montaigne.
Titulaires Associé(e)s Professeur émérites Doctorants
Axes de recherche Manifestations
- L’étude des pratiques sociodiscursives francophones (quotidiennes, littéraires, médiatiques, politiques,
- entre autres.) d’Afrique et du Maghreb ;
- L’intermédialité ;
- Les situations sociolinguistiques et la dynamique des langues africaines en situation de contact avec le français ;
- Le français dans l’espace francophone et les politiques linguistiques sous-jacentes.
Ces axes de recherche connaissent un regain de dynamisme depuis la création en 2005 du Réseau Discours d’Afrique, dont est membre le CELFA, qui rassemble des chercheurs et enseignants-chercheurs de tous les continents. L’hypothèse fondatrice de ce Réseau de recherche est celle d’une singularité des productions verbales francophones d’Afrique en prise avec la complexité de la mondialisation et de la circulation des discours. D’où l’élargissement du champ de recherche à l’étude de la pluralité des discours sociaux francophones en interaction et en confrontation.
Présentation du Réseau Discours d’Afrique
La création du Réseau Discours d’Afrique en 2005 à l’Université de Franche-Comté (Besançon) résulte d’un constat : les études des productions littéraires d’écrivains francophones d’Afrique se sont largement développées alors que la recherche sur les médias et le discours politique sont encore timides.
Or la créativité observée dans les œuvres littéraires en français d’auteurs africains, elles la partagent avec les médias. Le recours conjoint et incessant à des formes stylistiques spécifiques, à la valeur esthétique de l’hybridité des langues africaines et du français atteste que la dynamique langagière propre notamment à la presse satirique enrichit dans la foulée le champ politique et le discours quotidien. Ce génie imaginatif permet aux journalistes de ménager ainsi un environnement favorable à la captation de l’audience et à la fidélisation du lectorat africain. Si les pratiques socio-discursives circonscrivent les limites qui séparent les domaines littéraire, politique, médiatique, et quotidien, la mise en discours des faits sociaux suppose une imbrication d’univers langagiers différents.
En ouvrant le chantier de la réflexion sur les productions verbales d’Afrique francophone, le Réseau Discours d’Afrique définit un champ de recherches qui n’implique pas seulement le discours politique, ni le discours littéraire par exemple, mais englobe la pluralité des discours sociaux en interaction et en confrontation.
L’hypothèse fondatrice est celle d’une singularité en prise avec la complexité de la mondialisation et de la circulation des discours. Quel que soit le domaine envisagé, les formes des discours sociaux d’Afrique francophone sont différentes de celles à l’œuvre dans les discours de partout ailleurs. Afin de promouvoir une démarche scientifique qui rende compte de ces pratiques socio-discursives variées, se posent les questions suivantes : Quelle est la voie la plus rationnelle pour étudier la pluralité des discours d’Afrique francophone ? Sur quelles catégories faut-il s’appuyer pour l’analyse de ces discours ? Convient-il d’appréhender le discours politique, le discours littéraire, l’orature comme des genres de discours particuliers ou de minimiser ces distinctions pour mettre en exergue les notions de discours social et de formation discursive ? Quelles méthodes et quels outils sont les plus performants pour l’analyse des productions verbales orales et écrites en Afrique francophone ?
En prenant pour objet la relation entre formes discursives et identités africaines francophones, afin de contribuer à mieux comprendre la place de l’Afrique à l’heure de la globalisation, les travaux du Réseau Discours d’Afrique se fixent pour objectif de faire ressortir les spécificités expressives d’une diversité culturelle et de ses représentations, de façon à saisir à la fois les dimension sociale, économique, politique et poétique des pratiques langagières d’Afrique francophone.
2025, 5 déc. : Audrine NSHIMIRIMANA CORRE, "Pratiques discursives hétérogènes/dessins de presse au Sénégal" [Soutenance de thèse]
Soutenance de thèse d'Audrine NSHIMIRIMANA CORREA : vendredi 5 décembre 2025 à 14h, amphithéâtre de la Maison des Suds - Esplanade des Antilles - Université Bordeaux MontaigneEn vue de l'obtention du ...
2025, 21 novembre : " Textures et tessitures de la mémoire dans l’œuvre de Gisèle Pineau " [Journée d'études]
Ces travaux se déroulent dans le cadre de la Manifestation scientifique et culturelle, “Résonances mémorielles” que le CELFA organise avec le DEFLE, Département d’Etudes de Français Langue Etrangère, ...
Nos équipes internes:
CEREC
Centre d’Études et de Recherches sur l’Europe Classique

CEREO
Centre d’Études et de Recherches sur l’Extrême-Orient
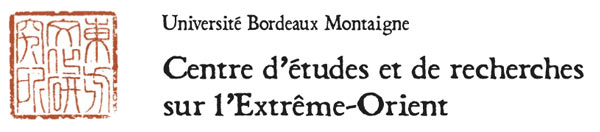
CES
Centre d’études slaves

CIRAMEC
Centre d’information et de recherche sur l’Allemagne moderne et contemporaine