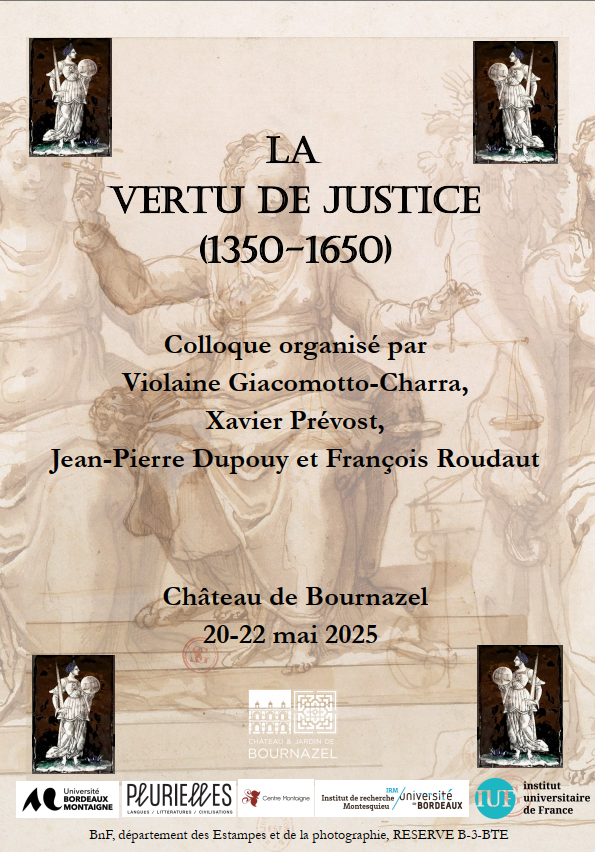2025, 20-22 mai : "La vertu de justice. 1350-1650" [colloque]
Violaine Giacomotto-CharraLa Vertu de Justice (1350-1650) - Colloque au Château de Bournazel, 20-22 mai 2025
Org. Violaine Giacomotto-Charra, Xavier Prévost et François Roudaut, avec le soutien de l’Association des Amis du Château de Bournazel
Des quatre vertus premières des Stoïciens, devenues les vertus cardinales dans le monde chrétien, la Prudence, la Tempérance et la Force ont fait chacune l’objet d’un volume paru aux éditions Classiques Garnier (respectivement en 2012, 2019 et 2024) et comprenant environ vingt-cinq articles auxquels succède une anthologie de 400 pages. Chaque fois, la vertu est étudiée dans le cadre d’une période qui va du Moyen Âge à l’âge classique. Pour compléter cette œuvre de cartographe, il convient maintenant de consacrer une réflexion à la quatrième vertu, la Justice. Cette réflexion prendra la double forme d’un colloque et d’une publication aux éditions Classiques Garnier, qui accueillera les actes du colloque, ainsi que des contributions supplémentaires et, comme dans les autres volumes, une anthologie de textes.
Définie par les philosophes antiques, en particulier par Platon et Aristote, la Justice fait ensuite partie des quatre vertus cardinales et se trouve au cœur de la réflexion des premiers Pères de l’Église, au premier rang desquels Augustin d’Hippone. Thomas d’Aquin la définira, en reprenant une formule du jurisconsulte romain Ulpien compilée au Digeste (D. 1, 1, 10), comme « une volonté constante et perpétuelle de donner à chacun ce qui lui appartient » (« Justitia, perpetua et constans voluntas est, jus suum unicuique tribuens », Somme théologique, Ia IIae, q. 58, art. 1).
La conceptualisation de la vertu de Justice occupe de ce fait une place cruciale dans la civilisation du Moyen Âge puis de la Renaissance, qui organisent des sociétés dans lesquelles les vertus sont omniprésentes, à la fois comme horizon d’attente et instrument de régulation. Dans ce cadre, la vertu de justice est particulièrement importante en raison de sa valeur à la fois religieuse et civile. Seule vertu absolument bonne, elle concerne l’individu et son comportement personnel, familial et social ; mais également le groupe, l’organisation de la société et les pratiques sociales et culturelles ; et enfin les régimes politiques, la foi privée aussi bien que la vie publique. À ce titre, elle relève tout autant de la philosophie et de la théologie que de la morale et du droit et donne également lieu à de nombreuses représentations dans la littérature et les arts. On ne compte plus en effet les représentations graphiques, personnifications ou allégories, de la justice et des autres vertus, ainsi visuellement et concrètement présentes dans la vie quotidienne.
Or si la vertu de Justice a été étudiée pour le Moyen Âge, en particulier sous la forme de ses représentations italiennes, si des colloques ou des ouvrages ont pu être consacrés aux notions de justice et de juste, si l’on trouve des études sur des théologiens, des juristes, des représentations artistiques, il n’existe pas d’étude d’ensemble qui croise tous les aspects et tente d’en mesurer les variations et les évolutions, tant par rapport à la période médiévale qu’au fil d’une longue Renaissance. Or, en sus du renouveau qui affecte profondément le monde de l’art, le tout début du xve siècle voit la tenue du Concile de Constance dont l’impact se fait sentir dans la vie religieuse, tandis que sous l’influence de l’humanisme se modifie la pensée politique et juridique, et s’élaborent de nouveaux traités de morale ou d’éthique cherchant à définir les normes d’une vie civile juste. Des théologiens aux juristes, des peintres aux poètes, des paysans aux princes, des villages aux palais, des traités d’éthique et de civilité aux monuments que sont les œuvres de Machiavel ou de Jean Bodin, comment se développe et se diffuse le thème des vertus et des vices et parmi eux, la vertu de Justice ? Quels liens entretient-elle avec les autres vertus ? Quelle place occupe-t-elle dans leur hiérarchie ? Quelles en sont les définitions religieuses, théologiques, philosophiques, juridiques dans la durée comme dans le vaste espace – temporel et spatial – de la Renaissance européenne ? Quelles en sont les transformations, les infléchissements, les variations, les nuances, en particulier sous l’influence de l’humanisme ? Comment s’inscrit-elle dans la réalité de la vie religieuse, politique, civique et sociale et quelles sont les voies de sa laïcisation, privées comme publiques ? Comment se modifie son iconographie avec l’avènement de la Renaissance, italienne d’abord, européenne ensuite ? Comment cohabitent vertu de justice chrétienne et éthique païenne, en particulier l’éthique aristotélicienne ? Quelle place occupe-t-elle dans la littérature ?
Le colloque, comme l’ouvrage qui en sera issu, sera donc pluridisciplinaire et fera appel aux historiens, aux historiens du droit, aux historiens de l’art, aux philosophes et aux littéraires. Toutes les pistes pertinentes touchant à la vertu de Justice peuvent être proposées et des articles de synthèses alterneront avec des études plus ponctuelles. Comme pour les volumes précédents, la seconde partie de la publication comprendra une anthologie qui permettra au lecteur de mieux interpréter les textes de ces époques anciennes dont bien souvent nous avons perdu quelques-uns des codes de lecture.
Le colloque aura lieu au château de Bournazel, dans le cadre du développement de ce haut lieu de la Renaissance au service des études sur cette période. Vingt communications pourront être retenues pour le colloque même, en raison du nombre limité de chambres, mais d’autres pourront être retenues pour la publication et nous lançons donc également un vaste appel à contributions écrites.
Violaine.Giacomotto@u-bordeaux-montaigne.fr
xavier.prevost@u-bordeaux.fr
francois.roudaut@univ-montp3.fr
Comité scientifique :
Outre les trois organisateurs :
Florence Buttay (professeur d’histoire moderne, Université de Caen)
Géraldine Cazals (professeur d’histoire du droit, Université de Bordeaux)
Jean-Pierre Dupouy (MCF honoraire de littérature de la Renaissance, Université de Bretagne Occidentale, co-responsable de la publication)
Manifestations associées
colloque
A découvrir :
2022, 1er janvier : l'UR Plurielles voit le jour
À tous et toutes les chercheurs et chercheuses de Plurielles, nous souhaitons une lumineuse année 2022 !Que le lancement de notre équipe rayonne de vos découvertes.Sans oublier de vous garder tous et ...
2022, 17 janv. : Thème Traduction, plurilinguisme et cosmopolitisme [Réunion]
La rencontre des chercheurs intéressés par le thème transversal « Traduction, cosmopolitisme, plurilinguisme » aura lieu le lundi 17 janvier 2022 de 15h à 16h30 en H 106.Pas de lien zoom. Pour tout re...
Consultez nos séminaires
Consultez ICI la liste de nos séminaires
2022, 1er av. : Enseigner la Bible en traduction dans le secondaire [Conférence de Claire Placial]
Vendredi 1er avril 2022 – 9h30-12h30 salle I003 - entrée libreDans le cadre du séminaire « Le geste comparatiste entre pensée de la traduction et tact critique »Conférence de Claire Placial : Enseigne...