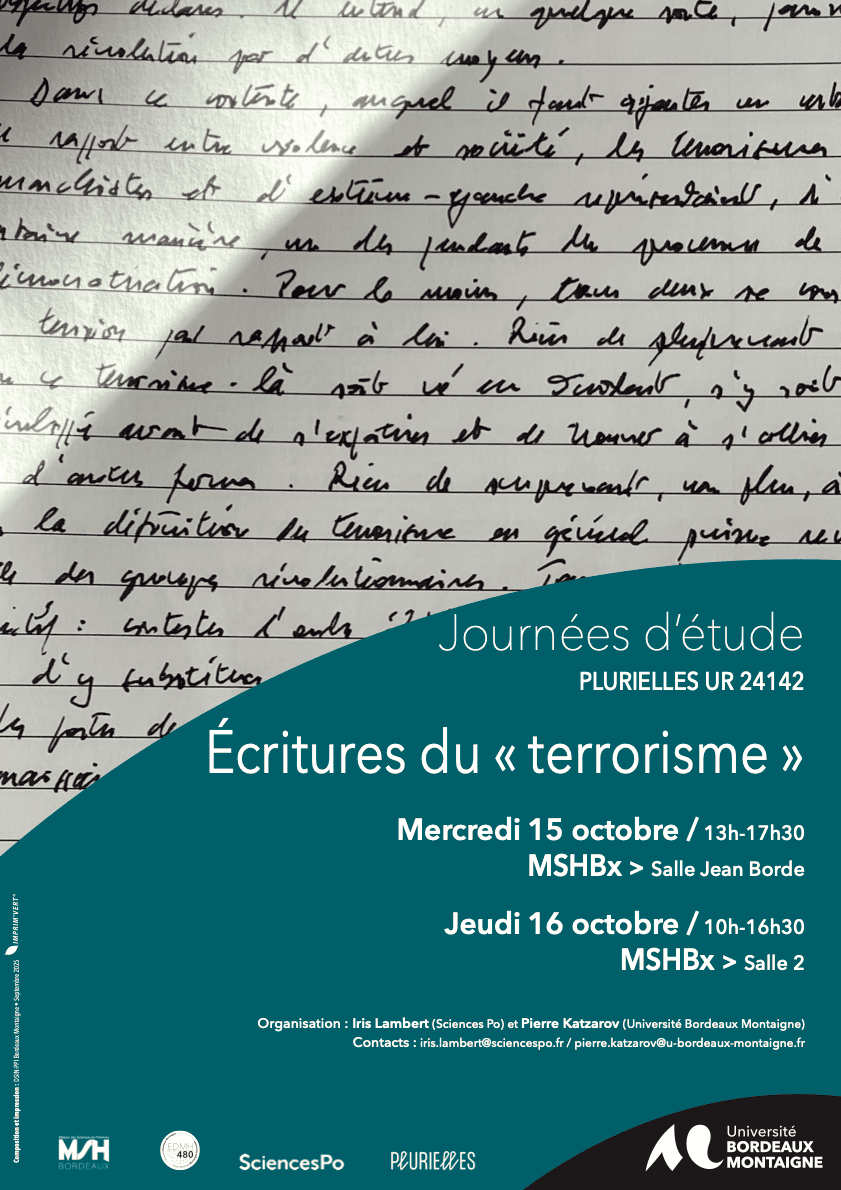2025, 15-16 octobre : "Écritures du terrorisme" [journées d'étude initialement prévue en mars]
Pierre KatzarovJournées d’études
Écritures du terrorisme. Perspectives historiques et transdisciplinaires
15 et 16 octobre 2025, Université Bordeaux Montaigne, Campus de Pessac (tram B. Arrêt “Montaigne-Montesquieu”)
Maison des Sciences humaines Bordeaux Aquitaine
Salle Jean Borde et Salle 2
Événement initialement prévu en mars
Programme
Mercredi 15 octobre (Salle Jean Borde)
13h15 – Mot d’accueil et ouverture des journées
13h45-15h / AXE 1 – Normes et écrits de « terroristes » : le cas des FARC
13h45 – Iris Lambert (CERI, Sciences Po)
« Normativité rebelle : code de conduite et droit international humanitaire dans la pratique guerrière des FARC-EP
14h15 – Sebastian Acevedo Ojeda (CRIMIC, Paris-Sorbonne / Visioconférence)
« Bataille culturelle entre terrorismes : la diabolisation des mouvements insurrectionnels et la justification du terrorisme d’État en Colombie »
15h – Pause
15h30-17h / AXE 2 – Écriture et représentation du « terroriste » et du « terrorisme » : littérature et cinéma
15h30 – Aurélien Berset (Université de Neuchâtel)
« Les Assassins, métaphore de la terreur politique. Des Considérations sur la Révolution française de Mme de Staël au Roman du terrorisme de M. Trevidic »
16h – Kirsten Behr (Universität Kassel / Visioconférence)
« Staging Terrorism : Terror de Ferdinand von Schirach et Djihad d’Ismaël Saidi »
16h30 – Pause
16h45 – Erik Pesenti Rossi (Université de Strasbourg)
« Réflexions sur Piazza Fontana de Marco Tullio Giordano (2012) »
19h30 – Diner
Jeudi 16 octobre (Salle 2)
10h-12h / AXE 3 – Table ronde / La lettre de la loi
Discutantes : Helin Köse (CAVEAT), Clémence Pellissier (Trinity College Dublin / Visio), Marie Schroeder (CDPC, Université Nanterre)
[ Pour l’instant, Olivia Ronen n'est plus dans le programme]
Modération : Nicolas Cohen (Avocat, Jus Cogens)
12h30 – Déjeuner
14h-16h30 / AXE 4 – Entretiens : Pratiques et enjeux de terrain
14h – Entretien avec un travailleur humanitaire et discussion (modération Iris Lambert)
15h – Pause
15h15 – Entretien avec Hugo Champion et discussion (modération Pierre Katzarov)
16h15 – Clôture des journées d’étude
Éléments de réflexion
La question du terrorisme — ses processus, ses acteurs, ses menaces — semble omniprésente dans le paysage des sociétés démocratiques libérales occidentales, et notamment la France. Et ce quand bien même « la place prépondérante qui [est accordée aux attentats] et son effet de sidération dans l’espace public peuvent sembler sans commune mesure avec leur poids réel en comparaison d’autres menaces susceptibles de déstabiliser nos sociétés » (Aoun, Morin, 2020, 8). Mais cette place croissante du terrorisme dans les discours médiatique et politique trouve également un pendant dans des travaux scientifiques académiques qui n’hésitent pas non plus à prendre les discours pour objet. Ainsi, le terrorisme est un objet d’étude, plus qu’un simple fait, et se voit interroger comme une notion fondamentalement ambivalente, à la fois descriptive et normative.
Il y a dès lors un intérêt à étudier le terrorisme à travers une variété de perspectives qui permettent non seulement d’explorer ce que le terme décrit, mais qui (est) décrit (et comment). C’est en ce sens que la question des « écritures du terrorisme » gagne en pertinence : s’y trouvent désignées les différentes manières par lesquelles le phénomène dit terroriste — comme une des manifestations de l’extrémisme violent aujourd’hui — produit, suscite de la lettre et du discours, que cela soit par ses acteurs, contre ses acteurs ou sur ses acteurs.
En effet, à l’aune des technologies de l’information et de la communication en premier lieu, l’époque semble être à la polarisation des débats, et à la fragilisation des partages clairs (l’ont-ils déjà été ?) entre propagande, information et opinion. Dans le domaine du droit et de la justice, la « lutte contre le terrorisme » accompagne la création de dispositifs policiers, juridiques et légaux qui occasionnent aussi des transformations paradigmatiques. Du côté des arts, les productions culturelles fictionnelles qui prennent pour objet les acteurs du terrorisme se sont multipliées, et elles interrogent une certaine économie des discours sur le terrorisme qui est par ailleurs identifiée comme une « mythographie de la Terreur » (Zulaika, Douglass). Enfin, il existe des dispositifs concrets de prévention et d’accompagnement sur le terrain, dont les perspectives ont rapidement changé, au gré des urgences, depuis les premiers objectifs de déradicalisation jusqu’au plus récent désengagement.
Ainsi, en réunissant jeunes chercheuses et chercheurs, enseignantes et enseignants, magistrats et travailleurs sociaux, quatre axes visent à envisager ces différentes écritures. Les axes répondent d’un souhait d’étudier en synchronie différents aspects d’un même phénomène, mais chacun aspire à être traité selon une perspective historique que l’on peut faire débuter au XIXe siècle.
- ÉCRITS DE « TERRORISTES » — Le premier axe envisage d’abord les écrits et les discours qui émanent des organisations dites terroristes : propagande, normes produites en interne, diffusion, réception des discours. Dans le même temps, ce sont aussi bien les contre-discours, et le recours à la qualification de terroriste qui mérite d’être pensés. Il pourra être précieux de se tourner vers l’évolution des moyens à disposition de la diffusion propagandiste.
- LA LETTRE DE LA LOI — Le deuxième axe se tourne vers un espace juridique et légal. Comment évolue le texte de la loi face au terrorisme ? Comment les pratiques juridiques, le rôle et la figure du juge, de l’avocat, et de la prison en viennent à se déplacer ? Il s’agit de penser la façon dont l’évolution des moyens utilisés pour lutter contre le terrorisme peut conduire à bousculer les distinctions entre exception et norme. Mais il sera également bienvenu d’interroger le terrorisme et la figure du terroriste comme des qualifications juridiques et historiques : dans l’histoire des moyens de répression légale, le terroriste, comme fiction juridique, a-t-il d’autres avatars ?
- ÉCRITURES ET REPRÉSENTATIONS DU TERRORISME — Le troisième axe souhaite appréhender les réactions culturelles aux attentats, à travers l’écriture et le cinéma. Comment appréhender les fictions, littéraires ou cinématographiques, qui ont pour objet le terrorisme et ses acteurs ? Quelle place leur accorder, à côté de productions testimoniales ou documentaires ? Que disent-elles de notre rapport et de nos attentes collectives vis-à-vis de ces deux pratiques esthétiques ? Un ensemble de questions qui couvrent un terrain, qui va de l’évolution des conventions narratives et esthétiques au statut de l’archive, afin d’approcher celle de la politique de l’art en regard du terrorisme.
Organisation : Iris LAMBERT (CERI, IEP Paris) et Pierre KATZAROV (Plurielles, UBM)
Manifestations associées
journée d’étude
A découvrir :
2022, 1er janvier : l'UR Plurielles voit le jour
À tous et toutes les chercheurs et chercheuses de Plurielles, nous souhaitons une lumineuse année 2022 !Que le lancement de notre équipe rayonne de vos découvertes.Sans oublier de vous garder tous et ...
2022, 17 janv. : Thème Traduction, plurilinguisme et cosmopolitisme [Réunion]
La rencontre des chercheurs intéressés par le thème transversal « Traduction, cosmopolitisme, plurilinguisme » aura lieu le lundi 17 janvier 2022 de 15h à 16h30 en H 106.Pas de lien zoom. Pour tout re...
Consultez nos séminaires
Consultez ICI la liste de nos séminaires
2022, 1er av. : Enseigner la Bible en traduction dans le secondaire [Conférence de Claire Placial]
Vendredi 1er avril 2022 – 9h30-12h30 salle I003 - entrée libreDans le cadre du séminaire « Le geste comparatiste entre pensée de la traduction et tact critique »Conférence de Claire Placial : Enseigne...