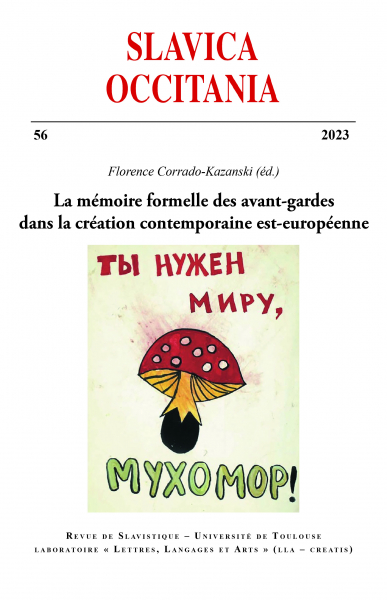La mémoire formelle des avant-gardes dans la création contemporaine est-européenne
CORRADO-KAZANSKI Florence (dir.), La mémoire formelle des avant-gardes dans la création contemporaine est-européenne, Toulouse, Slavica Occitania, 56, 2023.
En ce début de XXIème siècle, les enjeux mémoriels continuent d’occuper une place cruciale dans l’espace est-européen : en particulier, les regards portés sur l’histoire du XXème siècle dessinent une alternative radicale entre guerre des mémoires ou reconnaissance de mémoires plurielles, seule à même de fonder le vivre-ensemble. C’est dans cette perspective des mémoires plurielles, décalée du terrain géopolitique vers le champ artistique, que se situe notre réflexion sur la mémoire formelle des avant-gardes dans la création contemporaine est-européenne, dont l’une des ambitions est néanmoins de rappeler la dimension politique et éthique qui leur est inhérente.
L’objectif initial était de reconsidérer l’héritage des avant-gardes des années 1910-1930, qui est librement réévalué, approprié, prolongé, ou mis à distance par de nouvelles recherches formelles dans la création contemporaine, en Russie comme dans d’autres pays est-européens, tant dans le domaine des arts plastiques que celui de l’art verbal. En effet, la scène contemporaine n’a eu de cesse, depuis les années 90, de se confronter aux formes du passé, revendiquant la rupture ou la filiation, à travers des démarches de contestation, d’influence ou de réactivation. Les artistes et écrivains interrogent leur histoire, et cherchent à se positionner vis-à-vis des inventions formelles des avant-gardes, leur radicalité et leur caractère novateur.
Ce regard rétrospectif sur les avant-gardes du début du XXème siècle se veut pluriel à différents égards : d’un point de vue culturel, il s’agit d’un regard multiple, embrassant divers espaces - polonais, russe, biélorusse, slovaque, bulgare ; d’un point de vue temporel, non linéaire, ce regard peut être posé à partir de deux étapes, celle des artistes du souterrain des années 60, 70, 80, à l’intérieur d’un système socialiste ou soviétique, et celle de la création contemporaine de l’ère post – postmoderne, postsocialiste ou postsoviétique –, cette dernière gardant en mémoire la création artistique de cette « deuxième culture » tout en entretenant un dialogue avec les expérimentations artistiques du début du XXème siècle.
Ces voyages rétrospectifs, spatiaux et temporels, invitent à croiser la réflexion sur l’innovation et la radicalité des formes artistiques à celle de l’héritage, et par là à interroger la notion d’avant-garde (au singulier ou au pluriel) dans son rapport à la modernité, au modernisme et au post-modernisme, au fil de trois ensembles : « Formes en héritage », « Mémoire des figures », et « Gestes d’avant-garde ».